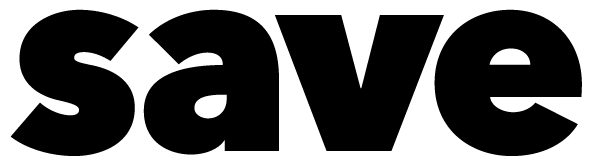La conduite automatisée : Chances et risques
La conduite automatisée révolutionne le trafic routier. Les systèmes d'assistance et d'automatisation doivent améliorer la sécurité et le confort - mais ils entraînent aussi de nouveaux défis. Et la question suivante se pose : quel degré de confiance et de responsabilité peut-on laisser aux systèmes ?
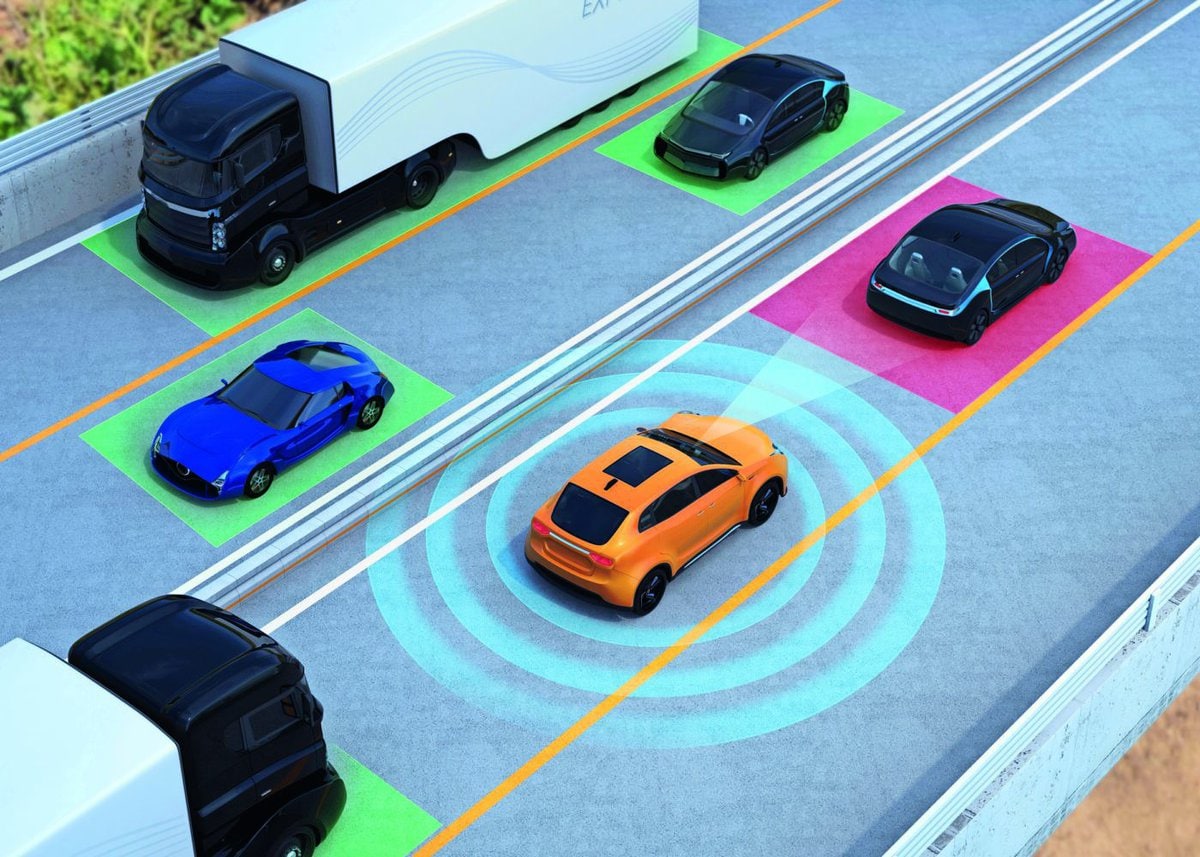
La conduite automatisée va modifier fondamentalement le trafic routier. De nombreux systèmes d'assistance à la conduite (SAC) sont déjà utilisés aujourd'hui. Des systèmes tels que l'assistance au freinage d'urgence, l'assistant de maintien de voie d'urgence ou l'avertisseur d'angle mort sont de plus en plus répandus et déjà prescrits par la loi pour tous les nouveaux véhicules en Suisse. Leur utilité préventive est scientifiquement prouvée. Le BPA souligne explicitement cette grande utilité préventive dans son portail de prévention Sinus plus (sinus-plus.ch) : "La technique de sécurité active dans les véhicules a un potentiel de prévention élevé. Elle avertit ou intervient dans des situations dangereuses et peut ainsi éviter des accidents".
Nouvelles exigences pour les usagers de la route
Parallèlement, les systèmes qui assistent en permanence la direction, le freinage et l'accélération (niveau d'automatisation 2), voire qui prennent entièrement en charge ces tâches par moments (niveau d'automatisation 3), gagnent en importance. De tels "véhicules de niveau d'automatisation 3" assurent en premier lieu un meilleur confort de conduite, par exemple sur les longs trajets sur autoroute. Mais ils posent aussi de nouvelles exigences aux usagers de la route, notamment en termes de compréhension du système, de compréhension continue de la situation actuelle du trafic et de disponibilité à prendre le relais à tout moment.
Plus ces technologies se développent, plus le besoin de règles claires se fait sentir. La Suisse a franchi une étape importante à cet égard en 2025 avec l'ordonnance sur la conduite automatisée : les véhicules avec fonction de prise en charge peuvent être utilisés sur les autoroutes sous certaines conditions - pour la première fois, il est permis de retirer temporairement les mains du volant. Les développements apportent de nouvelles opportunités - mais aussi de nouveaux défis. Par exemple en raison d'une confiance exagérée dans les systèmes, d'une baisse de la vigilance et de la difficulté à réagir de manière appropriée dans les moments critiques.
Cet article se concentre délibérément sur le niveau 3, dans lequel la tâche de conduite est partiellement prise en charge. Il s'agit de la forme de transition la plus importante en termes de sécurité entre la conduite manuelle et l'automatisation complète, où les exigences techniques, juridiques et humaines sont particulièrement condensées.
Qu'est-ce qui est autorisé - et qu'est-ce qui ne l'est pas (encore) ?
D'une part, la technique ouvre de nouvelles possibilités d'innovation dans le secteur de la mobilité et apporte confort et soulagement aux conducteurs. D'autre part, elle soulève des questions pratiques et juridiques, notamment en ce qui concerne l'exécution autorisée d'activités dites étrangères à la conduite.
La question centrale est la suivante : qu'est-ce qui est autorisé pendant que la tâche de conduite est justement exécutée de manière automatisée par le véhicule ? Cette question reste pour l'instant sans réponse dans l'ordonnance - elle ne précise pas quelles actions concrètes sont autorisées.
Un exercice d'équilibriste pour les activités étrangères à la conduite
Cette réticence réglementaire est compréhensible et reflète l'état actuel de la technique : les véhicules automatisés ne sont actuellement pas en mesure de garantir des fenêtres de temps suffisamment longues pour une reprise en main sûre en cas de distraction intense. De telles fonctions prédictives seraient pourtant nécessaires pour transférer la responsabilité de manière contrôlée et définie de manière plus concrète sur le plan réglementaire et pour permettre aux utilisateurs de disposer effectivement d'une plus grande marge de manœuvre.
Pour les conducteurs, il en résulte de nouvelles incertitudes quant à l'utilisation de tels systèmes et un dilemme en matière de sécurité. L'incertitude : il leur manque une orientation prospective. Ils ne peuvent pas savoir d'emblée avec certitude quelles actions sont autorisées. En cas d'incident, c'est un tribunal qui décide de l'adéquation des activités étrangères à la conduite effectuées.
Le dilemme : d'une part, ils sont formellement libérés de l'obligation de surveillance et peuvent se consacrer à des activités étrangères à la conduite dans le cadre des directives, mais ils risquent de ne pas pouvoir intervenir à temps en cas d'urgence. Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure une activité affecte la capacité de réaction. Néanmoins, les conducteurs doivent constamment évaluer ce dont ils se sentent "capables" dans une situation concrète - et risquent ainsi de surestimer leurs propres capacités.
"Les évolutions apportent de nouvelles opportunités - mais aussi de nouveaux défis. Par exemple en raison d'une confiance excessive dans les systèmes, d'une baisse de la vigilance et de la difficulté à réagir de manière appropriée dans les moments critiques".
La gestion des activités étrangères à la conduite devient alors un exercice d'équilibre : qu'est-ce qui n'est pas encore problématique, qu'est-ce qui est déjà risqué ? Où mettre les mains - sauf sur les genoux ? Le manque de clarté actuel rend difficile une utilisation sûre et standardisée de la technique.
La manière de gérer ces incertitudes dans la pratique se révélera avec l'expérience - et finalement par les premiers précédents dans la jurisprudence. D'ici là, la règle suivante s'applique : celui ou celle qui conduira à l'avenir le niveau 3 n'a officiellement pas le droit de faire grand-chose - et conduira de manière plus sûre si, dans la mesure du possible, il ou elle n'exerce pas d'activités étrangères à la conduite.
La formation à la conduite, un élément complémentaire pour une utilisation sûre du système
La technique à elle seule ne rend pas le trafic plus sûr. Son effet ne se déploie qu'en interaction avec des conducteurs compétents et bien formés, en particulier lors de l'utilisation de véhicules équipés de systèmes d'automatisation. La formation à la conduite joue ici un rôle central. Bien que les conducteurs doivent faire de moins en moins de choses activement, les exigences sont de plus en plus nombreuses et tout aussi exigeantes - par exemple en ce qui concerne la compréhension de ce que le propre véhicule peut réellement faire et où se situent ses limites. Une auto-évaluation réaliste et une réaction adaptée à la situation constituent également des défis. La formation à la conduite telle que nous la connaissons est-elle encore adaptée à cette situation ?
Depuis juillet 2025, les systèmes d'assistance à la conduite et d'automatisation sont obligatoirement intégrés dans la formation. Les futurs conducteurs ne doivent pas seulement apprendre comment utiliser les systèmes, mais aussi quand et pourquoi ils ne doivent pas leur faire aveuglément confiance. L'objectif doit être de transmettre une compréhension réaliste des possibilités et des limites de la technologie - et de renforcer la capacité à agir de manière sûre et responsable.
A long terme, il s'agira également de sensibiliser les conducteurs expérimentés à ces changements - par exemple par des offres de formation continue axées sur la pratique. Ce n'est que si tous les usagers de la route connaissent suffisamment les nouvelles technologies et les utilisent de manière compétente que le potentiel de l'automatisation pourra effectivement être exploité - et ce, de manière à ce que les gains de confort ne se fassent pas au détriment de la sécurité routière.
Et puis nous roulons sans guide
Les véhicules sans conducteur (niveau d'automatisation 4) assument entièrement la tâche de conduite, mais uniquement sur les tronçons autorisés par les cantons. Ils circulent déjà aujourd'hui dans le cadre de projets pilotes en Suisse. Contrairement au niveau 3, il n'est plus prévu de niveau de repli humain. Les exigences en matière de fiabilité du système, d'infrastructure bien développée et d'acceptation sociale augmentent donc considérablement.
En perspective, l'utilisation de tels systèmes se fera surtout dans le cadre d'offres de mobilité commerciales - par exemple dans les transports publics ou dans la logistique. Pour le transport individuel privé, le niveau 4 d'automatisation semble pour l'instant moins pertinent, notamment en raison des coûts techniques et économiques élevés. Toutefois, de nouveaux modèles commerciaux - comme les flottes partagées sans conducteur - pourraient conduire à l'émergence des premières applications dans le transport individuel motorisé.
Le rôle que l'homme jouera à l'avenir dans le trafic automatisé dépendra essentiellement de la mesure dans laquelle on parviendra à concevoir des systèmes automatisés fiables sur le plan technique, à les encadrer juridiquement et à les intégrer en même temps de manière sûre dans des contextes de trafic réels.