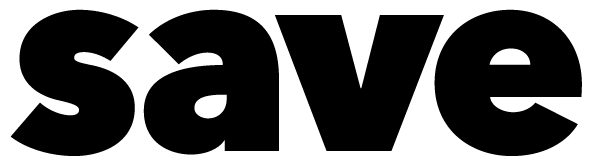Recherche pour la santé avec des matériaux innovants : "Il faut comprendre le système 'humain' dans son ensemble".
René Rossi, co-directeur du département "Materials meet Life" et du pôle de recherche "Santé", explique dans cette interview ce qui fait la particularité de la recherche dans le domaine de la santé à l'Empa, en quoi cela a un rapport avec les matériaux et sur quels thèmes se concentre la recherche de l'Empa.
Pourquoi un institut de recherche sur les matériaux comme l'Empa fait-il de la recherche biomédicale ?
Selon une étude de l'UE, environ 70% de l'ensemble des innovations sont induites par des matériaux. Il existe donc de nombreux champs d'application importants pour les nouveaux matériaux, entre autres dans le domaine de la santé. Prenons l'exemple d'un implant : il doit durer le plus longtemps possible, on veut éviter les infections, et la qualité de la surface doit garantir la meilleure intégration possible dans le tissu osseux, par exemple dans le cas d'une hanche artificielle - autant de sujets très complexes qui nécessitent un énorme savoir-faire en science des matériaux.
Qu'est-ce qui caractérise les projets de l'Empa dans le domaine de la santé - qu'est-ce qui les rend si particuliers ?
Dans la collaboration avec nos partenaires cliniques, nous constatons souvent un processus "push-pull", déclenché par un dialogue intensif. Les projets les plus réussis sont ceux qui naissent directement dans l'environnement clinique, en interaction avec nos partenaires hospitaliers. Nous montrons les possibilités technologiques de nouveaux matériaux, nos partenaires nous disent où le bât blesse dans le quotidien clinique. Ils savent exactement où se situent leurs problèmes - mais souvent pas qu'il existe déjà des solutions pour certains d'entre eux. Cet échange intensif est absolument essentiel - et pour cela, il faut prendre le temps d'instaurer la confiance et la compréhension mutuelle. Au début, cela a été un processus d'apprentissage pour nous aussi.
De plus, beaucoup de nos partenariats, notamment dans le domaine clinique, sont basés sur le long terme. Cela nous permet de développer des technologies à différents niveaux de maturité, on parle de "Technology Readiness Level" (TRL), du premier prototype en laboratoire à la solution prête à être commercialisée que nos partenaires peuvent utiliser et mettre en œuvre. C'est pourquoi nous entretenons des partenariats stratégiques avec des centres sélectionnés, comme l'hôpital cantonal de Saint-Gall et les hôpitaux universitaires de Zurich et de Berne. Troisièmement, nos projets sont hautement interdisciplinaires.
Qu'entendez-vous par là, comment cela est-il vécu à l'Empa ?
Pour nous, cela signifie aborder un problème sous des angles très différents, c'est la seule façon de reconnaître le potentiel d'une véritable nouveauté. Avec toutes les sciences naturelles et de l'ingénieur réunies sous un même toit - de la nanotechnologie et de l'analyse des surfaces aux technologies des textiles et des fibres, de la biologie moléculaire et cellulaire à la biomécanique et à la modélisation -, l'Empa est naturellement prédestiné à cela. D'un autre côté, les technologies modernes de la santé sont, par essence, des sciences systémiques qui réunissent des dizaines de disciplines. Il faut comprendre l'ensemble du système "humain" pour développer des solutions efficaces dans le domaine de la santé - du niveau moléculaire à la physiologie du corps humain, y compris les aspects psychologiques et sociologiques.
Comment doit-on s'imaginer un produit Empa typique pour des applications cliniques ?
Les pansements "intelligents" en sont un exemple. Les processus de cicatrisation des plaies sont énormément complexes et se déroulent en différentes phases ; le pansement doit - idéalement - accompagner les différentes phases de manière optimale, surtout dans la phase d'infection, qu'il faut détecter et traiter à temps. Ce faisant, nous devons avant tout éviter qu'une plaie ne devienne chronique. Et plus tard, le pansement doit soutenir et accélérer le processus de guérison.
Un autre sujet d'actualité est la résistance croissante aux antibiotiques dans le monde entier. Pour ne pas encourager ce phénomène, nous ne devrions utiliser les antibiotiques que lorsqu'ils sont absolument nécessaires - nous devons donc détecter les infections le plus rapidement possible, par exemple à l'aide de capteurs qui indiquent ensuite une attaque bactérienne par un changement de couleur sur le pansement. Parallèlement, nous travaillons sur de nouvelles approches thérapeutiques alternatives, comme les matériaux "vivants" tels que les bactériophages - des virus qui tuent les bactéries et qui sont inoffensifs pour l'homme - ou les probiotiques, de "bonnes" bactéries. Et nous ne devrions également les "activer" que si la plaie est réellement infectée, par exemple en les encapsulant dans certains polymères qui ne libèrent leur contenu que si, par exemple, le pH de la plaie augmente, un indicateur précoce d'infection. Un pansement qui combine toutes ces différentes "capacités" serait ainsi un produit typique de l'Empa.
Le thème de la santé est toujours associé aux coûts. Où voyez-vous des possibilités de maîtriser les coûts de la santé ?
En premier lieu dans la prévention et le dépistage précoce. Les coûts de la santé augmentent fortement, surtout au cours des dernières années de la vie. Une approche possible serait de pouvoir accompagner et soutenir de manière optimale les patients âgés à l'aide de capteurs portables et de leurs jumeaux numériques. Le jumeau numérique pourrait, si nécessaire, proposer des thérapies personnalisées sur la base des données transmises par les capteurs. En outre, différentes études ont constaté que jusqu'à 50% de toutes les thérapies ne sont pas appliquées correctement. Si nous pouvions, grâce à un meilleur "health monitoring", augmenter la sécurité des thérapies, mais aussi l'observance - et donc, en fin de compte, le succès thérapeutique -, nous aurions beaucoup gagné.
Un regard vers l'avenir : qu'auriez-vous aimé réaliser avec votre recherche dans cinq à dix ans ?
Depuis 2023, nous avons lancé trois programmes "booster" à l'Empa, par exemple pour l'amélioration du traitement du cancer, la lutte contre la résistance aux antibiotiques et un sur le thème de la cicatrisation des plaies. Un pansement qui permettrait d'éviter les infections des plaies et surtout les plaies chroniques, par exemple chez les paraplégiques et les personnes alitées, mais aussi chez les nouveau-nés qui, pour une raison ou une autre, se trouvent aux soins intensifs - ce serait un succès formidable.
Et dans la recherche sur la démence, pour citer un autre exemple, ce serait un énorme pas en avant si nous pouvions détecter les premiers signes de la maladie à l'aide de diagnostics simples, par exemple en analysant les schémas de mouvements, les paramètres vitaux tels que la fréquence cardiaque et respiratoire, la température corporelle, les analyses sanguines, etc. dès les premiers stades. En effet, plus on intervient tôt dans les maladies dégénératives - ce qui n'est malheureusement pas encore possible à l'heure actuelle -, plus on a de chances de pouvoir au moins ralentir l'évolution de la maladie.
Source : Empa