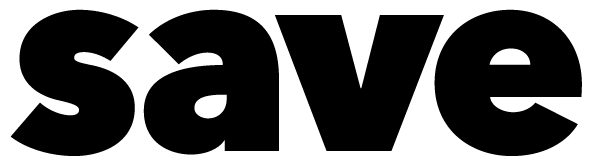La protection civile repensée
La situation en matière de politique de sécurité a fondamentalement changé - la pandémie Corona, la guerre en Ukraine et la crise climatique mettent la protection de la population au défi. Michaela Schärer, directrice de l'Office fédéral de la protection de la population, explique comment la protection civile est réorientée.

Madame Schärer, quelles sont les principales nouveautés du profil de capacité de la protection civile qui vient d'être adopté ?
Michaela Schärer : L'examen a montré que le profil de prestations existant correspond en grande partie aux besoins actuels. Toutefois, un profil de capacités est désormais défini au niveau fédéral, qui prescrit les capacités générales de la protection civile. L'organisation concrète - y compris l'organisation et les effectifs - reste du ressort des cantons.
Une autre nouveauté importante est la distinction entre les compétences de base et les compétences élargies. Les premières doivent être assurées par tous les cantons, les secondes constituent le cadre élargi et peuvent être couvertes par des groupements de compétences.
Il convient de noter que les capacités en rapport avec les conflits armés et dans le domaine du service sanitaire sont actuellement encore examinées et concrétisées dans des projets séparés.
Pourquoi était-il nécessaire de revoir l'ancien profil de prestations ?
Les expériences tirées de la pandémie de Corona et la situation fortement modifiée en matière de politique de sécurité, notamment la guerre en Ukraine, ont rendu nécessaire une révision et une adaptation du profil de prestations.
Quel sera l'impact concret du nouveau profil de capacités sur la formation, l'équipement et les interventions de la protection civile ?
Les cantons qui ne couvrent plus suffisamment certaines capacités aujourd'hui doivent les (re)mettre en place et les afficher dans l'effectif réglementaire. Dans ce contexte, la formation et l'équipement doivent également être assurés et garantis, par exemple en matière de localisation et de sauvetage.
"Une population peut devenir un facteur important en cas de guerre".
Comment réussir à garantir une mise en œuvre uniforme dans les différents cantons ?
Lors de la session de printemps, le Parlement a adopté la révision de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile. Celle-ci stipule également que les cantons doivent fixer le nombre de personnes astreintes souhaitées pour la protection civile sur la base de leur profil de prestations cantonal et de leur structure organisationnelle et le soumettre à l'OFPP. Cette procédure permet également de discuter de l'état de la mise en œuvre du profil de capacité dans le cadre d'un processus partenarial.
Quelles leçons l'OFPP tire-t-il de la guerre en Ukraine en ce qui concerne la résilience de la population suisse ?
Outre les enseignements tirés dans les domaines des ouvrages de protection, de l'alerte et de l'information de la population, des interventions de la protection civile, etc., la guerre en Ukraine ouvre également des perspectives sur la manière dont une société peut s'adapter avec succès à des changements massifs. Il convient de souligner en particulier le mouvement des volontaires. Après l'invasion russe de 2022, il est apparu clairement que les autorités civiles ukrainiennes et la protection civile atteignaient rapidement leurs limites. Là où des lacunes sont apparues, la population s'est organisée dans une large mesure de manière autonome. Elle aide par exemple les victimes de la guerre et soutient les réfugiés dans leur propre pays. Elle soutient en outre les autorités civiles dans la distribution de biens de secours ou la protection civile dans le sauvetage des décombres après des attaques de roquettes. Cela montre qu'en cas de guerre, une population peut se montrer fortement solidaire et devenir ainsi un facteur important dans la gestion d'un conflit armé. L'OFPP est convaincu que la Suisse, avec sa culture associative et de milice très marquée, dispose d'un grand potentiel à cet égard. La question se pose de savoir comment créer des conditions-cadres optimales pour que ce potentiel de résilience puisse se concrétiser en cas de besoin.
Quelle est l'importance de la modernisation des ouvrages de protection dans ce contexte ?
La Suisse dispose d'un système d'ouvrages de protection couvrant l'ensemble du territoire et comprenant des abris pour la population ainsi que des constructions protégées pour les organes de conduite et la protection civile. Ils constituent l'infrastructure centrale pour la protection de la population. Le maintien de la valeur des ouvrages de protection est donc primordial.
La protection de la population se concentre-t-elle désormais davantage sur les scénarios de conflits armés ?
Oui, le début de la guerre en Ukraine a remis le conflit armé sur le devant de la scène. L'OFPP crée les bases nécessaires à cet effet avec le projet "Protection de la population en cas de conflit armé". Il est important de mentionner qu'un conflit armé ne se déroule plus de la même manière aujourd'hui qu'hier. La conduite hybride des conflits, comme les cyberattaques, le sabotage ou l'espionnage, commence en particulier bien avant une attaque armée proprement dite. Malgré cela, les capacités de gestion des catastrophes et des situations d'urgence ne doivent pas être affaiblies, comme le montre la multiplication des événements liés au climat.
Comment évaluez-vous le potentiel des secouristes spontanés en cas de crise ?
Le potentiel d'intervention de secouristes spontanés lors d'un événement est important. L'OFPP a reconnu ce potentiel et va élaborer des bases permettant de l'exploiter.
Quels sont les défis liés à leur intégration dans les structures existantes ?
Les défis à relever sont par exemple l'enregistrement et l'accueil, la coordination des interventions et l'attribution des tâches, la direction et la conduite de l'intervention, les questions de sécurité et de responsabilité, la logistique, par exemple le ravitaillement et l'hébergement, la formation (ad hoc) et - un point central - la communication et l'information. Il est important que les secouristes spontanés puissent être engagés avec leurs compétences au bon endroit et au bon moment - sans se mettre en danger ou mettre en danger les forces d'intervention.

Existe-t-il déjà en Suisse des modèles ou des projets pilotes qui ont fait leurs preuves en matière de coordination des secouristes spontanés ?
Contrairement à d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne, la Suisse a encore relativement peu d'expérience en matière de gestion des secouristes spontanés. C'est pourquoi ce thème constitue également l'un des champs d'action de l'"Analyse des capacités de la protection de la population", adoptée par le Conseil fédéral en juin 2024 (1). Un groupe de travail de l'OFPP s'occupe de ce champ d'action en collaboration avec les cantons et la CRS. En effet, les secouristes spontanés sont un thème important pour la CRS, qui dispose également d'expériences en la matière.
Certains cantons ont déjà fait des expériences pratiques avec des secouristes spontanés, comme le canton du Tessin l'année dernière lors de la gestion des intempéries dans le Val Maggia.
"Avec le début de la guerre en Ukraine, le conflit armé est revenu sur le devant de la scène".
Quelles sont les principales opportunités, mais aussi les principaux risques liés à la numérisation de la protection civile ?
Le projet de numérisation de la protection civile (DIZIS) vise avant tout à réduire la charge administrative et à faciliter la communication et l'interaction entre les personnes astreintes et les services de la protection civile. Le projet est réalisé via une plateforme commune à l'armée et à la protection civile. Ainsi, les synergies peuvent être utilisées de manière optimale.
Où en est le projet DIZIS et quelles sont les prochaines étapes concrètes ?
DIZIS sera mis en œuvre en deux phases : Dans la phase 1 (2025 - 2026), il s'agit en premier lieu de numériser les processus administratifs en se concentrant sur le remplacement du livret de service physique par le gestionnaire de service électronique (DIM). Dans la phase 2, à partir de 2026, des processus interactifs entre les offices cantonaux de la protection civile et les membres de la protection civile doivent être mis en œuvre. Il s'agit notamment des demandes de déplacement de service et de congé ainsi que de la convocation numérique.
Comment mieux informer, sensibiliser et impliquer la population à l'avenir ?
Les autorités responsables de la gestion des événements disposent notamment des canaux Alertswiss pour informer la population. Non seulement les informations pertinentes y sont rassemblées en cas d'événements en Suisse, mais le site web et l'application proposent également des recommandations pour la prévention individuelle. Il est ainsi possible d'établir un plan d'urgence personnalisé qui aide à réagir rapidement et correctement. L'orientation stratégique de l'OFPP en matière d'information, d'alerte et de transmission de l'alarme à la population prévoit un développement continu de l'application et du site web Alertswiss. L'un des points forts de ce développement est notamment la mise à disposition d'informations importantes sur le smartphone sans connexion au réseau (p. ex. l'affichage des points de rencontre en cas d'urgence).
(1) news.admin.ch/fr/nsb?id=101580